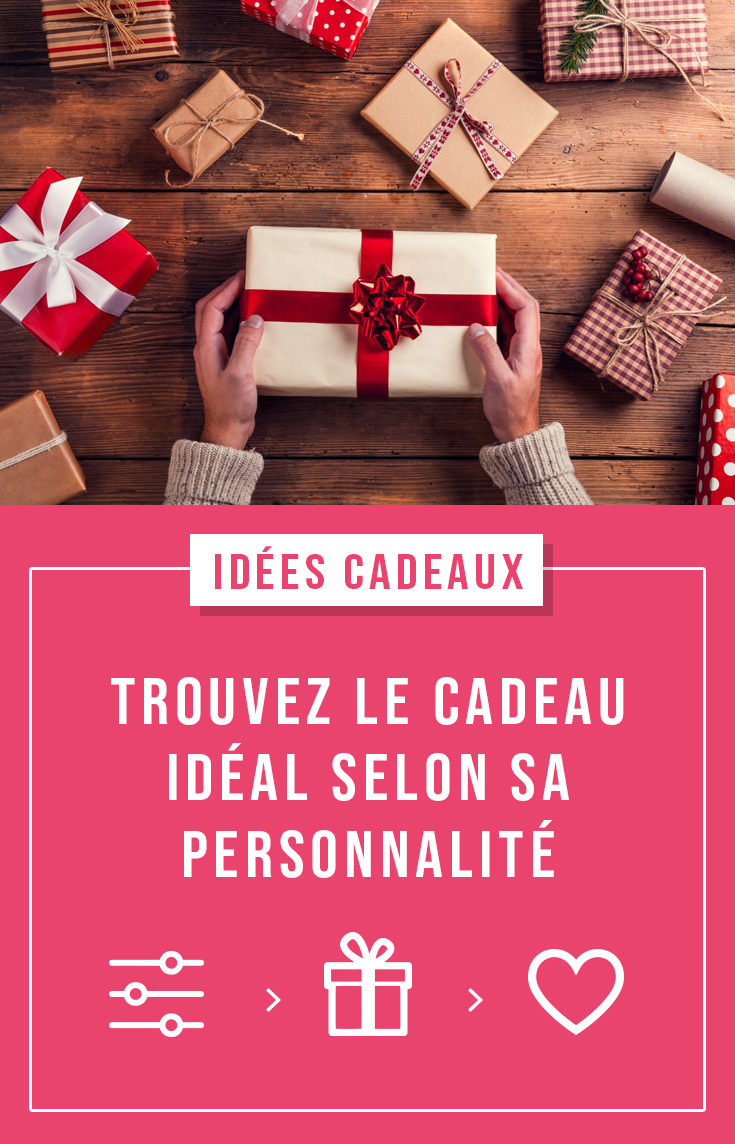La forêt Amazonienne : biodiversité, menaces, et conservation
Avant de devenir l’une des victimes des activités anthropiques, la forêt amazonienne était, et continue d’être, le plus grand trésor de biodiversité au monde.
Dans les eaux de son fleuve, sur ses sols humides, dans ses centaines de milliards d’arbres répartis sur plus de cinq millions de km², ce sont près d’un quart des espèces animales et végétales de notre planète qui ont trouvé un refuge, beaucoup d’entre elles nous étant encore totalement inconnues.
Là, au cœur d’écosystèmes complexes, cohabitent encore près d’une soixantaine de tribus totalement coupées de notre rythme de vie moderne, parlant différents dialectes et comptant essentiellement sur les services rendus par la nature.
De ce royaume végétal d’Amérique du sud, nous-mêmes tirons plusieurs bienfaits qu’il s’agisse des molécules de nos médicaments, des matériaux de construction ou de son rôle essentiel dans la régulation du climat.
Une abondance de la forêt amazonienne qui n’a d’égal que sa fragilité et dont l’équilibre délicat est sans cesse mis en péril par les incendies ou la déforestation massive.
Sommaire
La biodiversité : un autre monde sous les arbres
L’Amazonie est une vaste région étendue à travers le Brésil (à 63%), le Pérou, l’Équateur, la Bolivie, le Guyana, la Colombie, le Venezuela, le Suriname et la Guyane française.
Irriguée par l’un des plus vastes réseaux hydrographiques de la planète où se concentrent près de 20% de l’eau douce liquide disponible, la forêt amazonienne bénéficie d’un climat chaud et humide et d’une alternance régulière des saisons qui lui permet de rester verte en permanence
Cela notamment car l’eau circule en permanence, sous forme gazeuse ou liquide, grâce aux précipitations entretenues par la végétation elle-même. Au rythme de la respiration des arbres et des plantes, chaque molécule d’eau peut ainsi alterner entre pluie et vapeur d’eau jusqu’à 6 fois avant de quitter la région ou de regagner les mers.
Dans cette jungle amazonienne, près de 16 000 variétés d’arbres différentes s’y livrent une lutte sans fin pour la lumière et l‘eau, s’élançant parfois à plus de 60 mètres de hauteur pour capter les rayons du soleil dont la plupart ne parviendront pas à percer l’épais feuillage du couvert forestier. En contrebas, desmodium, houx, magnolia, ficus, albizia, plantes carnivores et fleurs exotiques croissent en nombre, parmi l’enchevêtrement dense des racines des arbres étendues à la surface du sol.
En savoir plus
Avec parfois jusqu’à 200 espèces végétales réparties sur un seul hectare, la forêt amazonienne profite d’une formidable hétérogénéité qui participe au maintien et à la résilience de sa biodiversité. Au cœur de la jungle se rencontrent près de 2,5 millions d’espèces d’insectes, 2500 de poissons, 500 de reptiles et de mammifères et quelque 1500 espèces d’oiseaux, nichant parfois dans les plus hautes strates de la canopée.
C’est ici que vivent encore le ouistiti pygmée, le tamanoir, le ara hyacinthe, la loutre géante, le dauphin rose ou encore le jaguar, tous désormais menacés d’extinction. Une faune exceptionnelle dont nous continuons de découvrir de nouvelles espèces chaque année et qui participe à la régénération de la forêt par la dissémination des graines de la même manière que les arbres contribuent à entretenir la fréquence des précipitations en aidant à la formation de nuages à basse altitude.
Dans ce microcosme où la forêt elle-même parvient à créer les conditions naturelles qui lui permettront d’exister, une multitude de relations écologiques se sont nouées entre les êtres vivants. Ce sont les relations entre les proies et les prédateurs par exemple, ou entre les hôtes et les parasites tandis que sous la surface du sol, une armée invisible de bactéries, de champignons et de micro-organismes est en permanence à l’œuvre.
Principale forêt primaire de la planète, essentielle à la régulation du climat de par sa capacité à rafraîchir l’air environnant et à agir comme un réservoir de carbone, la forêt amazonienne recèle bien d’autres trésors. De l’or, du cuivre, du nickel ou du manganèse, du bois ou des molécules végétales dont l’extraction toujours croissante ne cesse de se faire au détriment de la biodiversité locale.
Les menaces : un paradis vert en danger
Sous l’effet couplé des pressions humaines, la forêt amazonienne a déjà perdu près d’un tiers de sa superficie initiale. L’ouverture progressive des territoires des communautés indigènes aux entreprises minières et agricoles fait plâner un nombre toujours croissant de menaces.
La déforestation
Premier exportateur de bovins au monde, c’est notamment le Brésil qui impose un rythme insoutenable à la forêt amazonienne. Plusieurs millions d’arbres seraient ainsi coupés chaque année. Et l’élevage bovin en serait responsable à 80%, transformant morceau par morceau des espaces naturels sauvages en parcelles cultivées, destinées au soja qui servira à nourrir le bétail.
Pour gagner en temps et en rendement dans cette expansion agricole galopante, les parcelles de terre sont aussi défrichées par le biais de gigantesques incendies déclenchés volontairement. Des incendies favorisés par les sécheresses dues au réchauffement climatique, et qui gagneront souvent les forêts voisines.
Repartie à la hausse ces dernière année après une brève diminution sous la présidence de Luis Inacio Lula, la déforestation entraîne avec elle la disparition d’habitats naturels pour la faune et la flore. Les animaux qui parviendront à échapper aux feux (ce qui n’est pas le cas de tous) devront reculer au rythme de la disparition de la forêt, à la recherche d’un nouvel abri.
En savoir plus
La multiplication des infrastructures
Difficile d’envisager le développement humain sans celui des infrastructures énergétiques ou de transport. Mais la construction de routes au cœur de la forêt a rendu plus facile l’exploitation des ressources naturelles.
Aux abords de l’Amazone et de ses affluents, ce sont aussi les projets de barrage qui interrompent le tracé naturel des cours d’eau, détruisant les zones forestières dans lesquelles ils se trouvent, empêchent la circulation des espèces aquatiques et forçant les peuples autochtones à l’exil en morcelant les terres. Sous la pression d’une poignée d’organismes internationaux et du peuple Munduruku, un projet de méga-barrage sur le fleuve Tapajós a pu être annulé. Mais bien d’autres sont encore en discussion par le gouvernement brésilien.
L’extraction non durable des ressources naturelles
Au-delà de la surexploitation des forêts, ce sont aussi l’extraction du pétrole, des ressources minérales ou la surpêche qui vident la forêt amazonienne de ses richesses. Des prélèvements massifs qui se feront bien souvent de manière illégale et qui conduiront à l’érosion des sols et à la contamination des eaux. Le tout au détriment des communautés locales.
Le réchauffement climatique
Avec une hausse moyenne des températures d’environ 1°C au cours du 20e siècle, épisodes de sécheresse et incendies se sont multipliés au cœur de la forêt amazonienne.
Dans certaines régions, la saison sèche est passée de quatre à cinq mois environ tandis que certaines espèces d’arbres typiques des forêts tropicales régressent déjà au profit de variétés mieux adaptées à une faible disponibilité en eau.
Les forêts étant particulièrement sensibles aux changements globaux, l’effet du réchauffement climatique lié à l’utilisation de combustibles fossiles combiné à la déforestation peut rapidement impacter leurs capacités d’adaptation. À mesure que les arbres reculent, la fréquence des pluies diminue et les incendies liés à la sécheresse entraînent la perte d’autres arbres.
On estime ainsi que 40% de la forêt amazonienne pourrait se transformer en savane d’ici la fin du siècle si rien n’est fait pour limiter l’émission de gaz à effet de serre. Le point de bascule n’ayant jamais été aussi proche.
En savoir plus
Conservation : reforestation et engagements politiques
Malgré l’opposition des milieux militaires et conservateurs, la forêt amazonienne profite d’un nombre croissant de réglementations visant à garantir sa conservation sur le long terme.
En 2007 déjà, la France créait le parc amazonien de Guyane qui compte encore parmi les plus importantes aires protégées de forêt tropicale au monde. En 2016, c’est le groupe Carrefour, seconde chaîne de supermarché au Brésil, qui a choisi de frapper un grand coup en modifiant sa politique d’approvisionnement en bœuf à travers le pays afin d’aider à la lutte contre la déforestation. Le Groupe Casino et Walmart avaient déjà pris auparavant des engagements similaires.
L’année suivante, le plus vaste projet de reforestation jamais mis en place voyait le jour.
L’entreprise Rock in Rio s’est ainsi fixé pour objectif de reboiser 30 000 hectares de forêt jusqu’en 2023, en plantant 73 millions d’arbres issus de 200 variétés différentes. En parallèle, de nombreux programmes et subventions internationales visent aujourd’hui à protéger les populations indigènes et à agir positivement en faveur du climat et de la biodiversité.
Des mesures de grande ampleur, auxquelles nous pouvons tous prendre part à notre échelle, à travers de petits gestes quotidiens. En commençant par repenser nos habitudes alimentaires pour limiter la présence de viande dans nos assiettes par exemple, ou en refusant les produits à base d’huile de palme dont sont produites 66 millions de tonnes par an.
En privilégiant également les produits équitables issus d’Amazonie telles que les noix du Brésil et en veillant à ne sélectionner que du bois certifié lors de nos achats de meubles ou de matériaux. Inutile de se tourner vers les essences tropicales importées parfois illégalement de l’autre bout du monde lorsque la France est déjà le premier producteur de chêne, de hêtre et de peuplier.
D’un simple clic, il sera enfin possible de soutenir les ONG et les programmes internationaux en effectuant des dons ou en partageant la situation préoccupante dans laquelle se trouve aujourd’hui la jungle amazonienne, ainsi que les mesures mises en place pour la préserver.
Des efforts cumulés essentiels lorsque l’on sait que seuls 1,5% des 210 milliards d’euros engagés par la communauté internationale pour contrer les effets du changement climatique ont pour l’heure été consacrés à la déforestation. Puisque l’on estime que 55% de la forêt amazonienne aura disparu d’ici à 2030 si le rythme de la déforestation ne ralentit pas, il devient urgent d’agir aux-côtés des décideurs politiques pour ne pas perdre l’un de nos principaux puits de carbone et avec lui, la biodiversité la plus florissante de la planète.