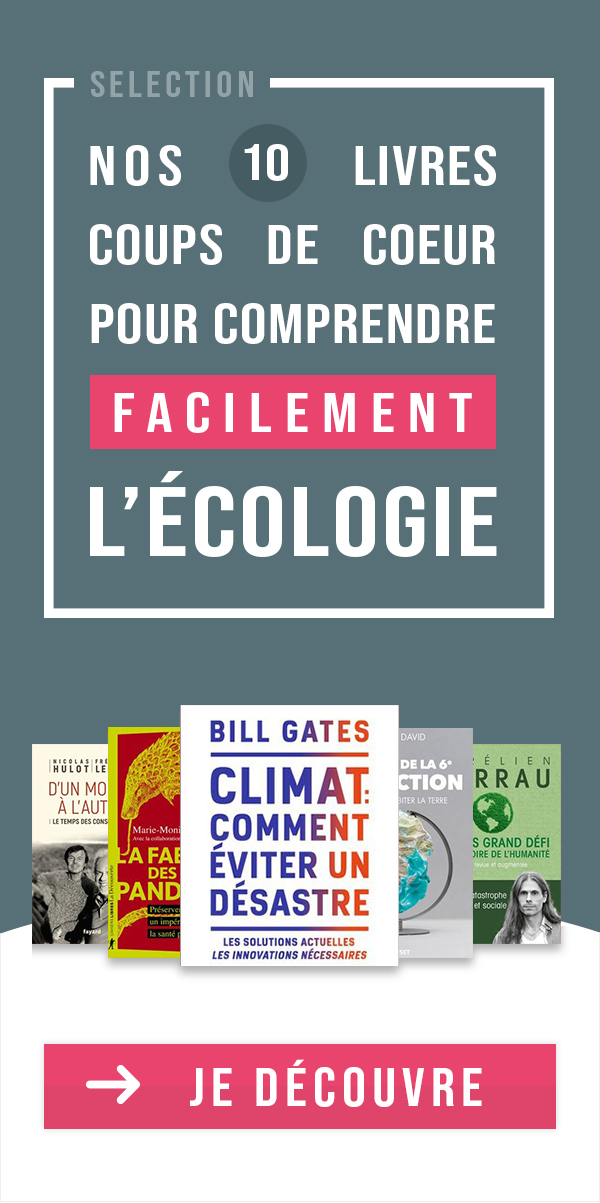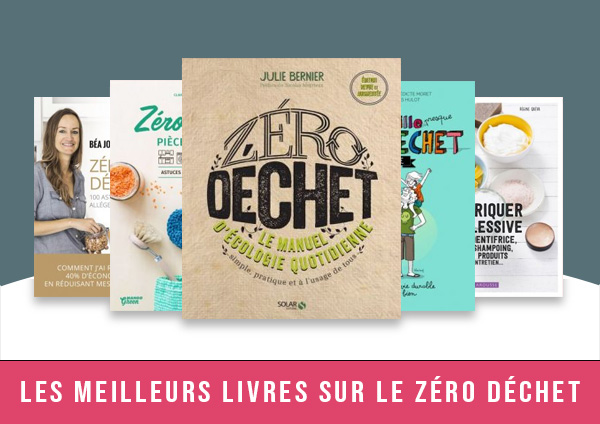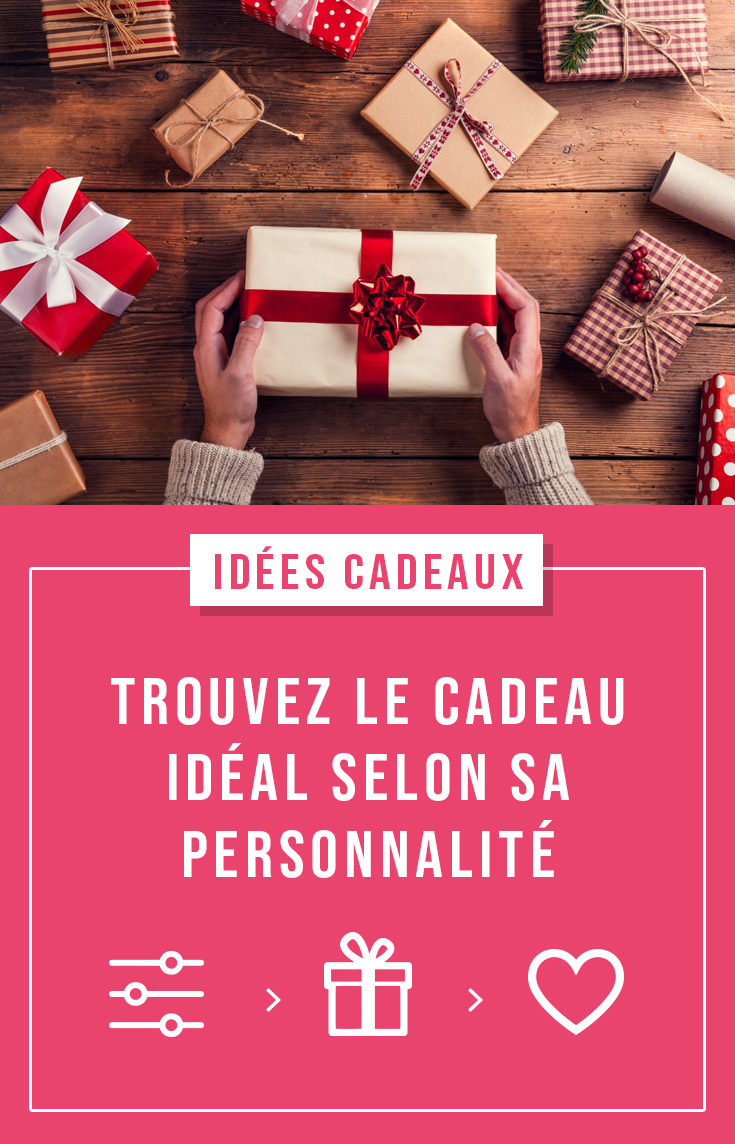Braconnage : une des plus grandes menaces pour la biodiversité
Définition : Qu’est-ce que le braconnage ?
Le braconnage c’est l’action de chasser ou de pêcher de manière illégale soit en s’attaquant à des espèces protégées, soit en œuvrant sans autorisation et en utilisant des moyens non autorisés.
À la différence de la chasse légitime à laquelle se livrent par exemple les populations autochtones dans les forêts tropicales pour se nourrir, le braconnage ne tient compte d’aucun quota de prélèvement de la faune sauvage.
Sont principalement menacés les éléphants d’Afrique, les rhinocéros, les grands singes et les félins, mais ce sont en tout plusieurs milliers d’espèces qui sont traquées à travers la planète pour leur peau, leurs cornes et pour servir d’attractions.
Après la capture, un véritable trafic se met en place via un commerce illicite soutenu majoritairement par les populations les plus pauvres et par des réseaux mafieux de plus en plus organisés. Il faut dire qu’il y a beaucoup à gagner dans ce type d’économie parallèle et que les sanctions sont en revanche très limitées.
Comprendre facilement le braconnage
La prise de conscience écologique a permis une certaine médiatisation de l’urgence climatique ou de l’impact négatif de nos déchets, mais la nature est aussi mise en danger de bien d’autres façons.
Le braconnage représente par exemple l’une des principales menaces écologiques sur la faune, aux côtés de la perte et de la fragmentation des habitats naturels. Et le danger est d’autant plus grand que les bandes organisées se durcissent et se multiplient tandis que les politiques restent globalement insuffisantes.
Sommaire
Qui sont les braconniers ?
Finie l’image du chasseur en tenue coloniale parcourant la savane, le fusil à la main, les braconniers d’aujourd’hui opèrent dans des réseaux quasi professionnels. Ils ont recours à des kalachnikov ou des fusils à visée nocturne, et se déplacent en camion ou en hélicoptère, principalement à travers les continents africain et asiatique.
Avec près de 7 à 23 milliards de dollars par an pour le seul commerce illégal d’espèces sauvages (et bien davantage si l’on considère l’ensemble des crimes environnementaux), le braconnage et les trafics associés figurent parmi les activités illicites les plus lucratives au monde, juste derrière le trafic de drogue et le trafic d’armes.
L’argent récolté sert ensuite en partie à financer des groupes armés comme Al-Qaida en Irak, ou les Janjawid au Soudan. Au total, plusieurs pays d’Afrique de l’Est et d’Asie du Sud-Est jouent un rôle de nœuds du trafic.
État des lieux du braconnage
Chaque année, entre 63 et 273 millions de requins sont tués par la pêche, et de nombreuses espèces marines, d’oiseaux, de reptiles et de mammifères subissent une pression forte liée au commerce illicite.
En France, des estimations d’ONG évoquent jusqu’à 500 000 oiseaux capturés illégalement certaines années (dont 30 000 bruants ortolans), malgré les interdictions. Quant à la civelle, cette petite larve d’anguille d’Europe, si elle est aujourd’hui en danger critique d’extinction c’est parce qu’elle constitue un plat de luxe dans les pays asiatiques, et qu’elle subit un braconnage sans précédent.
Du côté de l’Afrique, plus aucune région n’est épargnée. Parmi les populations d’éléphants, le Great Elephant Census a mis en évidence une baisse d’environ 30 % (–144 000) des éléphants de savane entre 2007 et 2014, et la mortalité liée au braconnage a culminé à plus de 10 % en 2011 avant de retomber sous 4 % en 2017, avec de grandes disparités régionales. Il resterait environ 28 000 rhinocéros (toutes espèces confondues) sur notre Terre.
Pour ce qui est des girafes, il aura fallu moins de 30 ans pour voir leur population diminuer de 40 %. Au Kenya, l’affaire de 2020 sur les girafes blanches tuées n’a laissé qu’un seul mâle porteur de leucisme.
Quant aux primates que l’on retrouve dans les forêts tropicales ou équatoriales du monde, quatre des six espèces de grands singes sont classées « en danger critique d’extinction » (deux gorilles et deux orangs-outans). Les gorilles de montagne dépassent 1 000 individus et les gorilles de plaine de l’Ouest se comptent par centaines de milliers, malgré un déclin préoccupant.
En prenant un peu de distance pour nous rapprocher des régions plus froides de notre planète, on constate que le braconnage a toujours cours puisque dans les régions arctiques, les ours blancs sont traqués pour leur peau. Leur déclin projeté (jusqu’à – 2/3 d’ici 2050) est toutefois principalement lié à la fonte de la banquise due au changement climatique.
Quant à la faune sous-marine, les océans ne lui fournissent malheureusement que très peu de protection. Au XXᵉ siècle, la chasse industrielle a causé la mort d’environ 3 millions de baleines. Parallèlement, le trafic de coraux (médecine, bijouterie) et la surpêche des esturgeons destinés au caviar illustrent l’ampleur du phénomène. Et forcément, plus l’espèce est menacée, plus elle coûte cher.
Quels sont les animaux les plus braconnés ?
Le pangolin
Le pangolin, qui a marqué notre histoire suite à la pandémie mondiale, est largement considéré comme le mammifère le plus trafiqué au monde à la fois pour sa viande et pour ses écailles à partir desquelles on fabrique des bijoux. Des estimations parlent d’ordres de grandeur autour de 100 000 individus par an.
L’éléphant
Des dizaines de milliers d’éléphants d’Afrique disparaissent selon les périodes, braconnés pour diverses raisons. Ce sont avant tout leurs défenses en ivoire qui se vendent à prix d’or sur le marché noir.
Malgré la fermeture du marché domestique de l’ivoire en Chine fin 2017–2018 et le durcissement très fort des règles dans l’Union européenne depuis 2021, le commerce illicite continue d’aller bon train. Des troupeaux entiers sont parfois décimés à coups de grenades et de fusils automatiques, pour le seul prélèvement des défenses.
Le rhinocéros
Le rhinocéros n’a pas de prédateur connu, à l’exception de l’Homme. Durant la seule année 2015, les braconniers ont tué plus de 1 300 rhinocéros en Afrique. Traqué pour sa corne, le rhinocéros noir d’Afrique de l’Ouest a vu ses populations chuter de 96%, avant de s’éteindre définitivement en 2011.
Aujourd’hui, de nombreuses autres sous-espèces restent confrontées à la même menace, pour les mêmes raisons. Le rhinocéros blanc est désormais l’un des animaux les plus prisés du marché noir. En cause, la médecine traditionnelle asiatique principalement, qui en a fait un remède contre des maladies variées.
Le tigre
Les tigres sauvages sont estimés à 5 574 individus en 2023 (en hausse par rapport à 3 200 en 2010). Il faut dire que le félin séduit de bien des façons : organes, os, dents, griffes, tous utilisés dans la médecine chinoise et circulant encore illégalement.
Le gorille
Menacés par le braconnage, les conflits armés et la perte de leur habitat, les gorilles de montagne dépassent 1 000 individus et les gorilles de plaine de l’Ouest comptent plusieurs centaines de milliers d’individus, même s’ils déclinent fortement. S’il se monnaye à des prix bien plus abordables, il attire pour sa viande et diverses parties de son anatomie mais se vend également vivant, comme animal de compagnie.
La tortue de mer
Sous les eaux, le braconnage est tout aussi répandu. La plupart des espèces de tortues marines sont menacées. Des dizaines de milliers d’entre elles sont perdues chaque année en raison de la surexploitation des océans et du commerce illégal de la faune.
Appréciée pour sa viande, ses œufs, son cuir et sa carapace, elle est aussi l’une des victimes collatérales de la pêche intensive et se retrouve fréquemment piégée dans les filets.
Le requin baleine
Plus gros parmi les poissons vivants, le requin baleine est chassé pour ses nageoires, sa peau et son huile, elle aussi supposée présenter des vertus médicinales.
Les procédés de chasse
Les méthodes employées, elles, restent barbares dans tous les cas. Au-delà des armes à feu, on note aussi le recours à de l’eau empoisonnée durant les saisons chaudes ou à de simples pièges abandonnés sur les sentiers fréquentés par des tigres le plus souvent.
Une fois tombé dedans, l’animal passera parfois plusieurs nuits à se débattre jusqu’à l’épuisement avant d’être achevé d’un coup de bâton. De leur côté, la plupart des espèces capturées vivantes mourront avant d’avoir atteint leur lieu de destination, du fait des conditions de détention et de transport épouvantables.
Les causes du braconnage
Le calvaire se poursuivra pour celles qui survivront au voyage.
Des mets raffinés pour l’élite
Zèbres, lions, hippopotames, singes, éléphants, tortues, serpents, girafes… La viande de brousse est considérée comme un mets de choix dans certaines régions d’Afrique et d’Asie. Intégrée à des plats typiquement exotiques, elle est proposée à un petit nombre d’adeptes fortunés, dans des restaurants exclusifs.
Les besoins de la médecine asiatique traditionnelle
On s’arrache aussi les dents, les yeux ou les os de tigre censés soulager l’arthrite et les rhumatismes selon les croyances de la médecine chinoise traditionnelle. Malgré des fermetures de marchés domestiques (Chine fin 2017–2018) et des durcissements en Europe, des ventes illégales persistent.
On prête en effet aux produits issus de la faune sauvage de nombreuses vertus. Le sang frais de serpent aurait ainsi un pouvoir aphrodisiaque, tout comme les écailles de pangolin, tandis que les cornes de rhinocéros réduites en poudre sont supposées soigner le cancer et les maladies cardiovasculaires.
L’attrait de l’exotisme
Véritable matériau de luxe, l’ivoire sera transformé en bijoux, en accessoires rituels traditionnels et en objets décoratifs. Proposé sur les étals des marchés aux côtés des hippocampes séchés et des bijoux en plumes d’oiseaux rares, il constituera un souvenir idéal pour les touristes désireux de ramener un petit quelque chose du bout du monde. L’Union européenne a fortement restreint en 2021 la quasi-totalité du commerce intérieur d’ivoire, même si des flux illégaux subsistent en ligne.
Autre aspect du tourisme, c’est aussi la chasse au trophée qui fait vivre le braconnage. Chaque année, de riches touristes venus d’Europe ou des États-Unis sont prêts à débourser plusieurs milliers d’euros pour avoir la garantie de tuer un lion. Alors pour satisfaire la demande, on crée des fermes où les lionnes enchaînent les portées et où les lionceaux ne seront élevés que pour être tués une fois adultes. Finalement, l’Afrique compte aujourd’hui davantage de lions en captivité qu’à l’état sauvage. Et pourtant les prélèvements dans la nature s’intensifient encore, notamment parce que les chasseurs de trophées sont plus intéressés par les animaux libres que ceux élevés en captivité.
Quant aux animaux destinés à être vendus vivants, certains deviendront des animaux de compagnie comme au Koweït, où il est devenu fréquent de cohabiter avec un animal sauvage. Les autres, et notamment les primates, prendront la direction des laboratoires où les grands singes sont très recherchés pour leurs similitudes avec les êtres humains.
Le marché de la fourrure
La fourrure quant à elle signe son grand retour dans le secteur du luxe. Au Canada par exemple, la moitié de la production de fourrure provient de prélèvements dans la nature, le reste étant issu d’élevages où le bien-être animal n’entre jamais en compte. Une peau de léopard des neiges peut ainsi se vendre à 70 000 €, tandis que la fabrication de châles en laine d’antilopes implique la mort d’environ 20 000 individus chaque année.
La perte des habitats naturels
Il faut savoir que le braconnage commercial n’est que l’une des menaces qui pèsent sur la faune sauvage. À côté de ça, le développement constant des populations humaines grignote chaque année un peu plus les habitats naturels des autres espèces. La déforestation, pour l’agriculture ou l’habitation, entraîne la disparition des forêts de toutes sortes où résident pourtant une quantité colossale d’espèces. D’après Greenpeace, 25 orangs-outans s’éteignent chaque jour en Indonésie, face à la progression des champs de palmiers à huile utilisés dans de nombreux produits du quotidien.
Et puisque l’espace vital de la faune sauvage se rétrécit, les animaux sont amenés à s’approcher un peu plus près des hommes mais la cohabitation est bien souvent difficile.
Alors les populations humaines autorisent ce que l’on appelle un «braconnage de représailles», sous prétexte de protéger leurs maisons et leurs activités. Au Botswana, la chasse aux éléphants interdite depuis 2014 a ainsi été rétablie pour stopper les animaux accusés de détruire les cultures.
Et la situation devrait se faire de plus en plus tendue dans les années à venir.
Les conséquences du braconnage
On évoque parfois la disparition des éléphants d’ici 2050. Le risque demeure réel dans plusieurs régions, même si certaines populations se stabilisent ou repartent à la hausse quand la pression de braconnage diminue.
Pour les tigres, des noyaux de population restent très vulnérables, l’effectif mondial estimé a toutefois augmenté depuis 2010 pour atteindre 5 600 individus (2023). Malgré cela, cette progression ne suffit pas encore à garantir la sécurité à long terme de l’espèce.
Toutes les espèces ont pourtant un rôle à jouer dans la nature, et l’extinction de certaines d’entre elles bouleverse le bon déroulement de fonctions écologiques essentielles.
Des écosystèmes fragilisés
Au Mozambique et dans d’autres pays lourdement marqués par le braconnage, on constate que de nombreux éléphants naissent désormais naturellement sans défenses. Elles leur sont pourtant indispensables pour creuser des trous à la recherche d’eau, et pour arracher un peu d’écorce à grignoter sur le tronc des arbres.
D’autre part, la viande de brousse, en plus d’être susceptible de transmettre des maladies à l’homme, met aussi en péril l’équilibre des écosystèmes naturels. Oiseaux, singes, chauve-souris, mammifères, tous participent à la régénération forestière en assurant la dissémination des graines.
En effet, au sein du règne végétal, certaines espèces de plantes ont appris à se disperser de manière autonome mais la plupart ont encore besoin du vent, de l’eau ou des animaux pour coloniser de nouveaux espaces.
Par le biais des déjections, des graines de fruits consommés, ou en s’accrochant simplement aux poils et aux plumes des habitants des forêts tropicales, elles parviennent ainsi à parcourir de longues distances pour se développer ailleurs. Entre 70 et 90 % des espèces de plantes à fruits dépendent des animaux pour la dispersion de leurs graines.
En tant que gros consommateurs de fruits, les primates et les éléphants ont un rôle tout particulier à jouer ici, d’autant qu’ils se déplacent très régulièrement. On constate d’ailleurs que certaines graines poussent mieux après avoir été ingérées.
Malheureusement, la disparition de la faune sauvage complique la dissémination des graines, et par extension la régénération des forêts. Celles-ci apportent pourtant une contribution incontournable à la planète, et à la lutte contre le réchauffement climatique qui nuit déjà à de nombreuses espèces.
D’autre part, la disparition des prédateurs au sein d’une chaîne alimentaire entraîne la multiplication des proies qui ont alors plus de difficultés à se nourrir et l’effet se répercute ainsi dans tous les maillons de la chaîne.
On estime que l’extinction d’une seule espèce peut conduire à la disparition d’une trentaine d’autres. Autrement dit, la préservation de la biodiversité est un point fondamental de toutes les politiques d’aujourd’hui.
Des risques sanitaires et sociaux
Responsable du déclin de la faune sauvage, le braconnage a également coûté bien des vies humaines du fait de la transmission de maladies virales et de l’abattage des gardes forestiers chargés d’assurer la protection des espèces menacées.
En Afrique, près de 600 rangers ont été abattus par des braconniers entre 2009 et 2016, dans l’exercice de leurs fonctions. Dans le parc national des Virunga en République démocratique du Congo, au moins 170 rangers ont perdu la vie au cours des deux dernières décennies.
Des moyens de subsistance limités
Dans les pays en développement, la faune locale est généralement considérée comme une ressource essentielle par de nombreuses communautés. Les plus pauvres, le plus souvent. Certaines populations rurales dépendent largement des animaux sauvages pour les protéines, des arbres pour le combustible et des plantes pour leurs remèdes naturels.
Des ressources indispensables qui tendent à se raréfier sous l’effet du braconnage.
Pourquoi est-il si compliqué de limiter le braconnage ?
De façon générale, les espèces sauvages sont intégrées à tellement de secteurs différents qu’il est très difficile de lutter contre des pratiques de ce type. D’un côté, nous avons les pays occidentaux ou les pays émergents d’Asie comme la Malaisie ou la Chine, qui contribuent à alimenter la demande et à soutenir économiquement ce marché parallèle. Et de l’autre, nous avons la pauvreté qui progresse en Afrique ou dans d’autres régions d’Asie. Le braconnage y représente pour beaucoup l’occasion de gagner un peu d’argent quitte à transgresser les réglementations établies.
En Tanzanie ou au Cameroun par exemple, le braconnage permet aux populations les plus pauvres d’acheter du sel, du carburant ou du savon, dans des régions où l’emploi est pratiquement au point mort sorti de l’exploitation minière et forestière. Avec des recettes annuelles estimées à plusieurs centaines de milliards de dollars, ce sont aussi quelques hauts fonctionnaires et responsables gouvernementaux qui en profitent, et qui maintiennent volontairement les restrictions à leur minimum.
D’autant que les armes modernes permettent une portée de tir de plus en plus précise, et que l’expansion des routes à travers les forêts facilite largement l’accès à des zones jusque-là relativement préservées.
La corruption, la pauvreté locale et la forte demande des grands marchés alimentent ces flux, tandis que le trafic migre de plus en plus vers Internet, compliquant l’application des lois.
Alors bien sûr, on enregistre quelques légères améliorations. En Afrique du Sud, 420 rhinocéros ont été braconnés en 2024, contre 499 en 2023.
Le panda géant, dont l’habitat est très sensible au changement climatique, est également menacé par des actes de braconnage mais ne fait plus partie des espèces en danger. Le panda roux, lui, reste ponctuellement ciblé.
Chez les éléphants d’Afrique, la mortalité liée au braconnage est passée sous 4 % en 2017 (après un pic de 10 % en 2011), un niveau encore trop élevé pour garantir un rétablissement partout. Ces animaux sont toujours menacés d’extinction.
Les solutions au niveau mondial pour lutter contre le braconnage
De manière générale, les pays sont tombés d’accord sur la stratégie à adopter.
Des restrictions plus strictes
Il est question notamment de renforcer les sanctions à l’encontre des braconniers et d’améliorer les moyens de recherche et de défense des équipes de protection sur le terrain. Meilleure puissance de feu, drones, puces électroniques implantées directement dans les cornes des rhinocéros, écornage, analyses ADN, de quoi déjouer l’organisation des réseaux de trafiquants qui s’avèrent pour le moment extrêmement difficiles à contenir.
Des systèmes récents comme les caméras “TrailGuard AI”, déployées depuis la fin des années 2010, détectent en temps réel les intrusions sur les sentiers.
Mais dans les faits, on constate que les discussions au sommet se révèlent beaucoup plus complexes.
Il y a quelques années, à la veille du vote sur l’interdiction du commerce du thon rouge lors de la 15ème Conférence des États Parties, l’ambassade du Japon organisait une réception au cours de laquelle étaient servis des sushis cuisinés à partir du fameux poisson. Le lendemain, l’interdiction commerciale était rejetée, de même que les demandes de protection des coraux et de certaines espèces de requins.
En 2013, ce sont les demandes de protection de rhinocéros et des raies qui n’aboutissaient pas, preuve selon beaucoup que la corruption joue un grand rôle jusque dans les prises de décision.
Certains produits issus de la faune sauvage sont même volés directement dans les stocks saisis, puis revendus au marché noir.
Malgré tout, la mise en place par le passé de certaines interdictions nous a déjà permis d’observer des conséquences positives. Depuis l’interdiction de la chasse à la baleine en 1982 par exemple, quelques populations d’espèces ont pu se rétablir. Les baleines grises sont passées de «en danger critique d’extinction» à «en danger», les baleines à bosse se reproduisent plus rapidement que prévu et les populations de rorqual commun, cousin des baleines, ont pratiquement doublé depuis les années 70.
Un constat positif, qui nous laisse à penser qu’un retour en arrière est toujours possible. Mais pour lutter efficacement contre le braconnage, c’est à chaque pays de renforcer sa propre législation et de réduire la demande locale. La Chine a d’ores et déjà interdit le commerce de l’ivoire depuis la fin d’année 2017 et l’Europe a durci sa réglementation en interdisant la plupart des formes de commerce d’ivoire, même si des contournements subsistent encore en ligne.
Des trackers pour le suivi de la faune
Inoffensifs et indétectables, ils pourront être utilisés afin de permettre aux gardes forestiers de collecter des données précises sur le nombre d’animaux d’une espèce donnée, leur emplacement et les menaces qui pourraient peser sur eux.
Une manière de lutter plus efficacement contre le braconnage mais aussi l’exploitation forestière et toute activité illégale, sans forcer les rangers à être directement présents sur le terrain.
Des gardes forestiers plus nombreux
L’insuffisance de rangers pose un problème majeur à la conservation de la faune. Davantage de cas de braconnage sont signalés dans les zones où les patrouilles sont plus limitées. Employer plus de gardes forestiers permettra forcément une surveillance accrue.
De nouveaux refuges
Certains animaux, au bord de l’extinction, ne peuvent être protégés que dans des sanctuaires. Il s’agira de les multiplier à l’avenir, et de définir plus précisément où commence et où s’arrête la terre faunique afin d’en bannir les constructions et la conversion en terres agricoles.
De quoi permettre un nouvel essor du tourisme dans les zones frappées par le braconnage où les espèces vivantes ont la capacité de rapporter beaucoup aux communautés locales. En Ouganda par exemple, les gorilles rapportent environ 1 million de dollars de revenus touristiques chaque année.
Une meilleure sensibilisation du public
Pour de nombreux produits dérivés de la faune sauvage, la demande est motivée par des traditions, dont beaucoup n’ont aucun fondement scientifique. L’éducation du public sur l’importance des animaux et le poids de la désinformation pourrait contribuer à réduire cette demande, et à freiner le cœur de l’industrie du braconnage. C’est ce qu’a entrepris notamment l’organisation African Wildlife à travers sa campagne Say No, qui a ciblé les consommateurs asiatiques à travers de nombreux panneaux d’affichage et vidéos choc.
D’ici là, il faudra aussi travailler à la préservation des habitats naturels et à la modification des comportements d’achat parmi les populations.
Les solutions au niveau individuel pour lutter contre le braconnage
Diminuer simplement sa consommation de viande et de poisson par exemple permet de ne pas encourager la surpêche et l’élevage intensif qui nécessite d’ailleurs beaucoup d’eau et d’espace et qui pèse lourd dans la déforestation mondiale.
Consommez mieux
On en profitera également pour ne consommer que des fruits et des légumes de saison, dont la production préserve les rythmes de la nature et bio de préférence, pour éviter les pesticides responsables de la pollution des sols et des nappes d’eau souterraines.
Et puis bien-sûr, on bannira définitivement certains produits alimentaires, notamment ceux issus de l’huile de palme. Pour rappel, sa production, ainsi que celle du soja qui est principalement destiné à l’élevage bovin, génèrent 80 % de la déforestation que l’on observe aujourd’hui en Amazonie.
En cas de travaux à la maison, on privilégiera les bois locaux comme le bois de chêne ou de châtaignier et l’on recherchera les labels FSC ou PEFC qui garantissent que le bois provient bien d’une gestion forestière durable. Des produits non certifiés peuvent entraîner des activités néfastes pour la faune et faire peser des menaces sur les habitats naturels.
Votre garde-robe enfin ne contiendra en aucun cas de fourrure véritable.
Voyagez responsable
Les petits gestes peuvent se poursuivre en vacances en ne participant pas à des attractions animales et en réfléchissant soigneusement aux souvenirs que vous emportez avec vous.
Prenez part à des projets
Et puis l’on n’hésitera pas enfin à soutenir des projets de conservation de la nature, en s’engageant par exemple auprès d’un groupe local de défense de l’environnement et en partageant nos valeurs autour de nous pour tenter de convaincre le plus grand nombre.
Conclusion
Les possibilités sont nombreuses, mais elles sont toutes d’égale importance. 60 % des espèces sauvages de notre planète ont disparu en l’espace de 40 ans et au rythme actuel qui est le nôtre, il faudra beaucoup moins de temps pour voir s’éteindre le reste.
Face à l’urgence environnementale, tous les acteurs, qu’il s’agisse des gouvernements, des industries ou des consommateurs, peuvent adopter les modes de comportement qui sauront faire une vraie différence. Reste à savoir quel rôle nous avons envie de jouer.
Sources
- UNODC – World Wildlife Crime Report 2024
- UNEP/INTERPOL – The Rise of Environmental Crime (2016)
- Great Elephant Census (résultats 2016)
- PeerJ (Elephant Census – analyse)
- Nature Communications (2019) – mortalité liée au braconnage
- DFFE (Afrique du Sud) – stats rhinocéros 2023
- Save the Rhino – 2023
- Save the Rhino – 2024
- WWF – estimation \~5 574 tigres (2023)
- WWF – Mountain gorilla
- IUCN Red List – Western lowland gorilla (PDF)
- USGS – Polar Bear Research
- Scientific American – chasse baleinière (bilan historique)
- NOAA Marine Fisheries Review (Rocha, Clapham, Ivashchenko 2015)
- Worm et al., Marine Policy 2013 – mortalité des requins
- Science/AAAS – tendances récentes requins
- BirdLife – ortolan (France)
- Science Advances (2019) – captures illégales en Europe
- TRAFFIC – pangolins
- IFAW – pangolins (FAQ)
- WWF – Chine ferme le marché de l’ivoire
- Commission européenne – règles UE 2021 (ivoire)
- Ivory factsheet (UE)
- IFAW – trafic d’ivoire en ligne (UE)
- RESOLVE/Intel – TrailGuard AI
- The Verge – présentation TrailGuard AI
Ces articles peuvent également vous intéresser
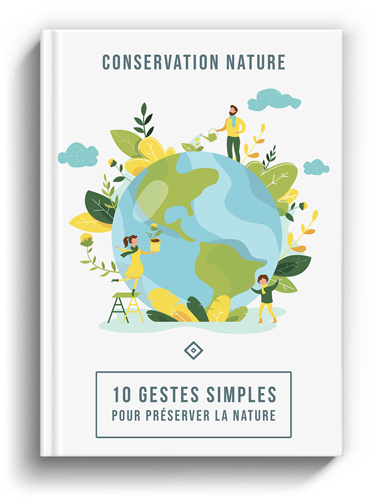
Recevez gratuitement notre ebook sur l'écologie
Envie de vous engager au quotidien avec des gestes simples ? Repenser nos comportements et la gestion de nos déchets est un moyen essentiel de contrer les effets dévastateurs liés aux dérèglements de notre planète.
Pour vous guider dans vos premiers pas, nous vous proposons gratuitement notre ebook pour toute inscription à notre newsletter. Vous y trouverez une synthèse avec des astuces simples à mettre en place, et des liens pour étoffer votre lecture.
Renseignez votre email, et recevez directement notre guide des « 10 gestes simples pour préserver la nature » ainsi que nos futures publications.