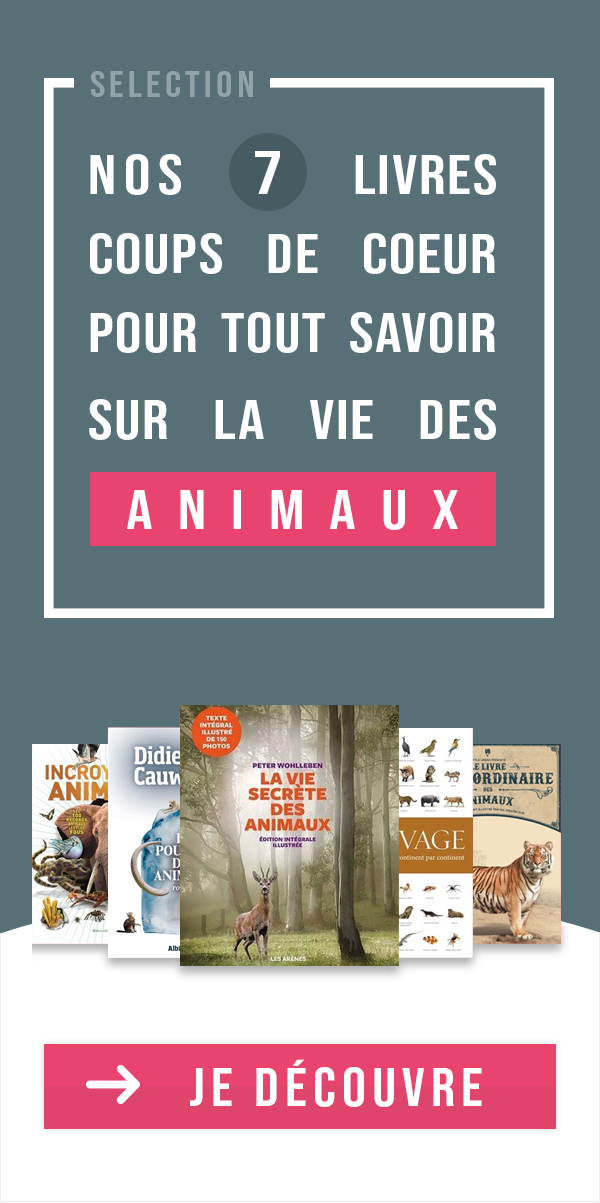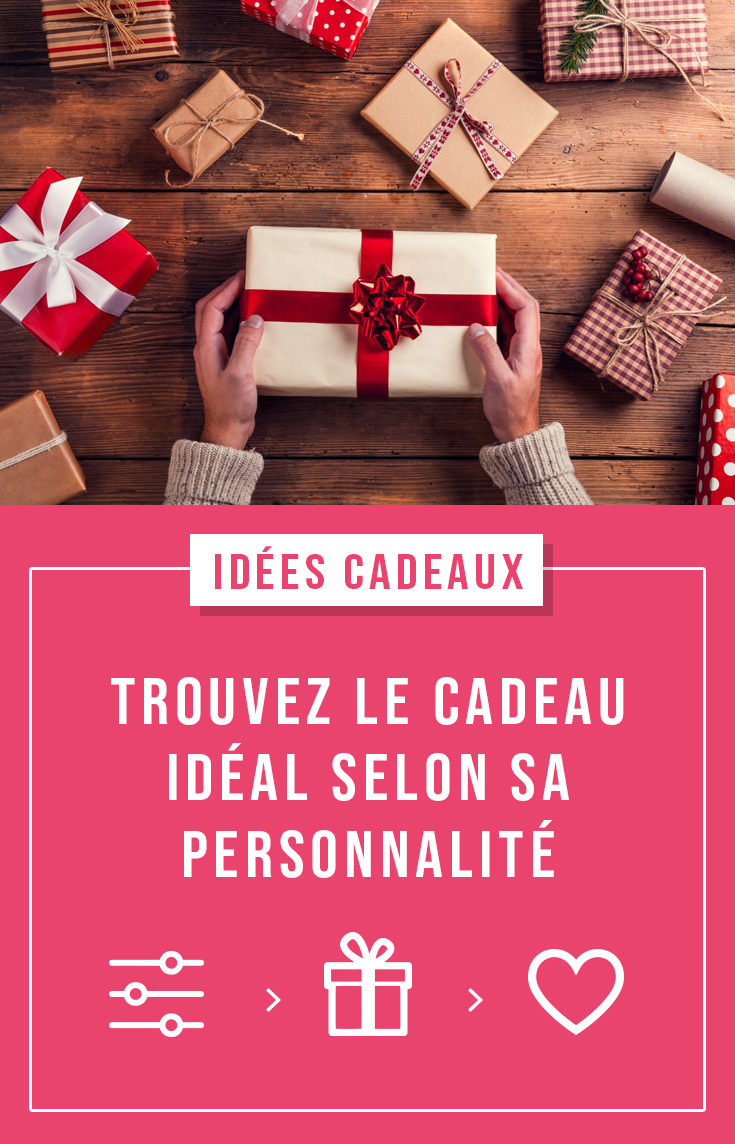Le gorille

Zones de répartition naturelle du gorille
Les gorilles sont présents dans dix pays de l’Ouest et du centre de l’Afrique, vivant dans les forêts équatoriales. Ils se déclinent en deux espèces : les gorilles de l’est et les gorilles de l’ouest. Ces deux espèces diffèrent par des caractères morphologiques, génétiques et éthologiques.
Ces primates, comme toutes les autres espèces de singes, sont menacées d’extinction à l’état sauvage. Ils sont présents dans dix pays de l’Ouest et du centre de l’Afrique, vivant dans les forêts équatoriales. Ils se déclinent en deux espèces : les gorilles de l’est et les gorilles de l’ouest. Ces deux espèces diffèrent par des caractères morphologiques, génétiques et éthologiques.
Les gorilles de l’est sont eux-mêmes divisés en deux sous espèces : les gorilles de plaine de l’est et les gorilles de montagne.
Les différentes espèces
Les gorilles de montagne
Les 700 gorilles de montagne (Gorilla beringei beringei) encore présents vivent dans la région de Virunga, aux frontières du Rwanda, de l’Ouganda et de la République Démocratique du Congo. Leur population n’a pas cessé de diminuer depuis 100 ans, date de leur découverte, suite à la chasse non contrôlée, aux guerres, aux maladies, à la destruction de leurs habitats et à la capture d’individus pour le commerce illégal d’animaux de compagnie. Tous ces facteurs laissaient penser que la dramatique décroissance des populations de gorilles de montagne conduirait à sa disparition au cours du 20ème siècle.
Les gorilles de plaines
Les gorilles de plaines (Gorilla beringei graueri), les plus grands de toutes les espèces de gorilles, vivent dans la République Démocratique du Congo. Ils sont moins menacés que les gorilles de montagne, bien que soumis aux mêmes perturbations que ceux-ci. Leur effectif est d’approximativement 17 000 individus. Les principales différences morphologiques qui les distinguent des gorilles de montagne, sont des dents et poils plus courts, ainsi que des bras plus longs.Enfin, on peut noter que le manque de réglementation dans l’aire de répartition de ces gorilles est un facteur aggravant.
Les gorilles de l’ouest
Les gorilles de l’ouest (Gorilla gorilla gorilla) vivent dans les forêts tropicales de plaine du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Cameroun et de République Centrafricaine, avec de plus petites populations en Guinée Equatoriale et au Nigeria. Leur effectif est bien plus important que les autres espèces avec près de 94 500 individus, mais ils sont néanmoins menacés de disparition. La déforestation et le commerce de viande de brousse (bushmeat) sont les principales causes de leur disparition.
Les gorilles de la rivière Cross
Le Nigeria et le Cameroun occidental abritent le gorille de la Cross (Gorilla gorilla diehli), une petite population de gorille de l’ouest, avec moins de 250 individus. Il diffère du précédent par une dimension crânienne et des dents différentes. Des mesures de conservation doivent être établies de manière urgente pour assurer leur conservation, suite à la destruction de leur habitat.
Un des plus proches parents de l’homme dans le règne animal (il appartient également à la famille des Hominidés), est aujourd’hui menacé d’extinction (classé comme en danger (EN) par l’IUCN depuis 1990). Les causes d’extinctions sont diverses et leur combinaison a aggravé la situation.
Différents projets de conservation sont en cours pour protéger ces animaux et leurs habitats, et ainsi que pour sensibiliser les populations locales.
Menaces
Toutes les espèces de grands singes sont menacées d’extinction dans un futur proche ou dans le meilleur des cas d’ici 50 ans si aucune action n’est entreprise pour assurer leur conservation.
La destruction de leurs habitats
La principale perturbation occasionnée aux populations de gorilles est la destruction de leurs habitats en général, et la déforestation en particulier.
Selon un rapport du Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE) publié en 2002, moins de 10% de l’habitat forestier des grands singes d’Afrique restera intact en 2030.
La déforestation est conditionnée par la nécessité pour l’homme de prélever du bois pour se chauffer et pour une utilisation industrielle, par l’ouverture du milieu pour une utilisation agricole et pour le développement urbain (habitations, routes,…). Elle s’est accélérée depuis les années 1980 avec l’installation d’entreprises étrangères exploitant le bois, si bien qu’une estimation indique qu’il n’y aurait plus de forêt primaire en Afrique d’ici 5 à 10 ans. L’ouverture du milieu à des fins agricoles est réalisée par des incendies, qui provoquent non seulement la destruction de l’habitat des grands singes, mais aussi une mortalité directe des singes et une baisse de leurs ressources alimentaires. La construction des routes entraîne une fragmentation du milieu et la destruction des derniers lieux de vie des grands singes, mais elle permet également de faciliter l’accès aux braconniers afin de chasser les adultes pour leur viande et les petits pour alimenter le commerce illégal d’animaux de compagnie (Dr Klaus Toepfer). Le Dr Klaus Toepfer, directeur exécutif du PNUE, précise à ce sujet que de nouvelles routes sont en construction en Afrique, pour des raisons d’extraction de bois, de pétrole et de minerais. Les forêts du Gabon et de la République démocratique du Congo abritent 80% de la population mondiale de ces animaux. Entre 1983 et 2000, plus de la moitié d’entre eux (56%) a disparu.
Il ne resterait plus que 40% de forêt primaire au Congo et 20% au Gabon.
Les maladies
Les maladies sont une deuxième menace à prendre en compte dans l’extinction des gorilles. Une des maladies frappant régulièrement les populations de gorilles (mais aussi de chimpanzés) est celle du au virus Ebola. Cette maladie touche également l’homme et provoque des fièvres hémorragiques conduisant généralement à la mort. C’est un virus très contagieux, qui se répand très rapidement. Le réservoir naturel du virus Ebola semble habiter les forêts tropicales d’Afrique et d’Asie, mais il n’a pas encore été identifié. Les épidémies de virus Ebola chez les grands singes ne résulteraient pas de la propagation d’une seule épidémie d’individu à individu, mais plutôt de contaminations massives et simultanées de ces primates à partir de l’animal réservoir à la faveur de conditions environnementales particulières (Science, 2004). S’il apparaît que les épidémies chez les primates surviennent principalement lors des changements de saison, on ne connaît pas cependant exactement les conditions environnementales requises pour leur émergence, ni quel est l’hôte, réservoir naturel du virus, qui contamine ces derniers. Les recherches sont en cours pour tenter de caractériser ces paramètres (Science, 2004).
Selon l’Institut de recherche pour le développement (IRD), durant les dernières épidémies d’Ebola, « des centaines, voire des milliers d’animaux seraient morts » dans le sanctuaire de Lossi, au Congo (Science, 2004)
Les grands singes peuvent également être victimes de maladies apportées par l’homme. Ainsi, dans le parc national de Gombe, en Tanzanie, plusieurs vagues de maladies respiratoires telles que la pneumonie ont entraîné des taux de mortalité allant jusqu’à 40 % chez les chimpanzés, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF).
La chasse
Bien que les gorilles soient des espèces protégées, la chasse fait encore partie des principales menaces, car elle représente une activité prospère dans des zones relativement pauvres. Le Fonds mondial pour la nature estime que l’homme tue chaque année entre 3000 et 6000 grands singes.
La chasse des gorilles, plus importantes dans les zones périphériques des villes, prend plusieurs formes : la chasse pour se nourrir (viande de brousse ou bushmeat), la capture de jeunes individus à diverses fins, les croyances locales,…
La viande brousse (singes, antilopes, éléphants,…) est une nourriture traditionnelle consommée pour des raisons spirituelles. Mais c’est surtout un marché lucratif dans les plaines du centre ouest de l’Afrique.
Une partie de ce « gibier africain » est expédiée par bateaux et par avions et sera servi dans certains grands restaurants européens. On estime qu’environ 800 gorilles par an sont tués pour cette utilisation.
Les jeunes individus sont capturés non pas pour être mangés mais pour être vendu sur les marchés. Ils sont généralement battus et blessés lors de la capture, si bien qu’un faible pourcentage d’individus subsiste. Ce commerce est le plus répandu au Gabon, Congo, Zaïre et Cameroun.
Les gorillons de montagne (Gorilla beringei beringei) ne sont plus chassés. Leur manque d’adaptation aux nouvelles conditions et leur vulnérabilité provoquaient la mort des individus. Tous les individus capturés dans les années 1960 – 1970 afin d’être placés en parc zoologique sont morts peu de temps après leur capture.
Certains gorillons seront capturés pour être engraissés puis consommés. Les jeunes gorilles traumatisés par la mort de leur mère meurent dans la plupart des cas de dépression ou de malnutrition. En effet, ils sont nourris principalement avec des bananes et du maïs, alors qu’ils étaient adaptés à une nourriture riche et diversifiée, provoquant des carences et des maladies avant d’atteindre le « poids idéal pour la consommation ».
Enfin la capture peut être destinée à des zoos, qui n’ont aucun objectif de conservation, et comme seul but la visibilité maximale des animaux dans un espace restreint.
De nombreux individus capturés sont destinés à l’accomplissement de croyances locales. Chaque partie du corps aurait des effets bénéfiques divers comme la force et la vitalité pour de la poudre de main séchée de gorille, une meilleure fertilité et des propriétés spirituelles pour la viande de gorille.
Les oreilles, langues, organes génitaux et petits doigts sont vendus aux sorciers guérisseurs qui leur attribuent des propriétés magiques
Les conflits civils se déroulant dans l’aire de distribution sont de plus en plus pris en compte. Ils obligent les paysans à quitter leurs fermes et à vivre dans les forêts où ils doivent chasser pour se nourrir.
Le tourisme
Le tourisme est lui aussi responsable de l’extinction des gorilles. Tout d’abord, comme il a été indiqué précédemment en tant que vecteur de maladies nouvelles, mais aussi car la sur fréquentation des forêts par les touristes, sans action directe sur les gorilles, provoque l’acclimatation à l’espèce humaine, les rendant plus vulnérables aux braconniers car moins vigilant.
La faible fécondité
Comme la plupart des anthropoïdes, les femelles gorilles sont réceptives sexuellement seulement lorsque leur petit dernier est sevré soit, vers l’âge de trois ou quatre ans. Etant donné qu’elles ne donnent naissance qu’à un seul bébé à la fois, qu’elles ne sont fertiles que vers 8-9 ans, que leur vie moyenne (de plus en plus courte) est entre 35 à 50 ans, et que leur gestation dure 8.5 mois, on estime qu’en moyenne une femelle peut donner naissance entre 4 à 9 gorillons au cours de sa vie. Il faut prendre en compte que les gorillons ne seront pas tous viables et que les femelles sont moins fertiles à un âge avancé.
Ce facteur rend les gorilles encore plus vulnérables. On comprend que la perte d’un individu dans une communauté, surtout une femelle, est devenue catastrophique pour cette espèce ancienne en voie d’extinction.
Conservation
Les premières associations de protection des grands singes ont vu le jour il y a près de trente ans : l’Institut Jane-Goodall a été fondé en 1977, la Fondation Dian-Fossey un an plus tard. Depuis, plusieurs dizaines d’organismes ont été créés. Beaucoup sont des fondations qui recueillent de l’argent dans les pays occidentaux afin de financer des actions de protection, de recherche et de sensibilisation des populations locales. Le Fonds Dian-Fossey finance ainsi le centre de recherches de Karisoke, au Rwanda, qui joue un rôle central dans la protection des gorilles des montagnes. Les agences des Nations unies (Unesco et PNUE), ainsi que les organisations de défense de la nature comme le WWF, participent, elles aussi, à la lutte en faveur des grands singes.
Ce travail sur le terrain, au quotidien, avec les populations locales est irremplaçable. Cependant, aucune action d’envergure ne pourra être réellement menée sans une véritable aide au développement, en particulier de l’Afrique.
Règlementation
Les grands singes figurent sur la liste des espèces menacées établie par l’UICN (Union internationale de conservation de la nature). Ils sont protégés par la loi dans tous les pays où ils vivent et sont classés dans l’Annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction (CITES), qui interdit leur commercialisation. Ce texte a été signé par plus de 160 pays dans le monde.
Mais sur le terrain, leur statut d’animaux protégés reste très théorique et n’empêche ni le braconnage, ni la destruction de leur habitat. Leur territoire est souvent difficile d’accès, ce qui complique les contrôles, d’autant que les pays qui les abritent manquent de moyens financiers et sont parfois le théâtre de conflits armés. Enfin, il est difficile d’interdire la consommation de viande de singe quand les populations locales souffrent d’une extrême pauvreté.
Mesures
Afin de coordonner tous les efforts menés dans le monde en faveur des grands singes, les Nations unies ont lancé, en 2001, le Grasp. Ce programme international regroupe les vingt-trois pays africains et asiatiques où l’on trouve encore des populations de grands singes en liberté, ainsi que des agences de l’ONU et des organisations non gouvernementales. Le Grasp sert à financer des actions de protection, d’étude des animaux et de sensibilisation des populations locales, ainsi que des actions vers l’élaboration des plans nationaux pour la survie des grands singes. Les principaux bailleurs de fonds sont des pays industrialisés comme la Grande-Bretagne, l’Irlande, l’Allemagne et la Norvège, mais aussi les pays concernés. Selon les experts du Grasp, un budget d’au moins 25 millions de dollars serait nécessaire pour empêcher l’extinction et garantir la survie de ces populations de grands singes. Afin de faciliter la mise en oeuvre de plans nationaux pour la sauvegarde des grands singes, le Programme des Nations unies pour l’Environnement et l’Unesco préparent une déclaration internationale qui devrait être signée en 2005 par les différents états abritant des populations de grands singes en liberté. L’Unesco et l’Agence spatiale européenne ont lancé fin 2003 le projet BeGO (Build Environment for Gorilla), qui permettra de surveiller l’évolution de l’habitat des gorilles en Afrique centrale grâce à des images satellitaires.
Parmi les « mesures clés » préconisées par les acteurs de terrain, on peut citer le renforcement des moyens de protection (formation des employés de parcs nationaux, des douaniers…) et la limitation des activités qui menacent l’habitat naturel des singes (exploitation minière, abattage des arbres).
Le WWF a établi depuis 2002 un programme de conservation sur les grands singes établis autour de six axes :
- Protection et gestion : Conservation de populations viables par une meilleure protection et gestion.
- Soutien de la communauté : Augmenter le soutien public destiné aux grands singes en réduisant le conflit humain –singe.
- Politique : Etablir des politiques de conservation, des stratégies et des lois pour limiter le braconnage des singes et la déforestation.
- Développement du savoir : Augmenter la capacité des états à conserver et gérer les grands singes.
- Commerce : Réduire le commerce international illégal de grands singes.
- Conscience : Faire prendre conscience au public du problème des grands singes.
Résultats
En Afrique centrale, la population de gorilles des montagnes recommence à croître. En janvier 2004, on comptabilise 380 individus dans la région des Monts Virunga, soit 17 % de plus que lors du dernier recensement (1989). C’est le résultat du travail mené par les équipes des trois parcs nationaux qui couvrent la région : le parc des Virunga (République démocratique du Congo), le parc des Volcans (Rwanda) et le parc Mgahinga (Ouganda).
Dans cette zone, une surveillance rigoureuse menée depuis trente ans – associée à une bonne coopération transfrontalière et à un écotourisme maîtrisé – semble permettre la sauvegarde de l’espèce. Ce résultat positif reste malgré tout précaire et devra être confirmé.
Conclusion
Il reste donc beaucoup de travail à faire pour la conservation des grands singes, que ce soit pour les gorilles détaillés ici que pour les chimpanzés, bonobos ou orangs-outans. La situation alarmante semble néanmoins provoquer une prise de conscience internationale, et a engendré la création de plusieurs programmes d’envergures internationales depuis le début du 21ème siècle.